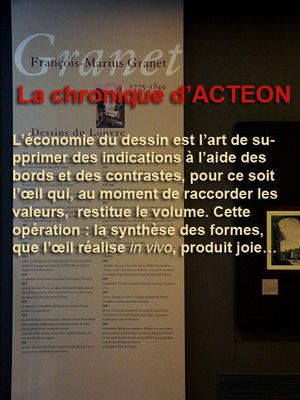vendredi, juin 30, 2006
samedi, juin 24, 2006
mercredi, juin 21, 2006
Manuscrit jazz quartet 03/2Partie

Suivre le récit à partir du début Manuscrit jazz quartet 01
Lire avant Manuscrit jazz quartet 03/1 partie
Le soir j’avais rendez-vous avec Alék. Il m’avait téléphoné : je lui parle du grand besoin que j’avais de me distraire ; il me propose de nous voir sur le Pont de la Tournelle, — près de là sur le Port, tu verras, il y a une esplanade avec deux « trous » où les gens dansent.
J’ai pris le vélos pour m’y rendre, c’était un peu comme revenir au monde. Je m’étais douché, je lui arrivais avec un polo blanc, pantalon beige. Parfumé. Il me manquait le Panama et les années 30.
En effet, il y avait comme deux sortes de trous : des cercles avec des gradins en dessous le niveau du sol. Dans l’un les gens dansaient le tango et dans l’autre la salsa. Deux ambiances complètement différentes, la première trop guindée, des gens en tenue, sérieuses, trop, quand on pense que c’était une danse des bas-fonds à Buenos-Aires, où l’homme est un maffieux et la femme une pute… Une pose de cours de danse, femmes célibataires du 16ème ? Je ne comprenais pas — quel intérêt trouvait-il là-dedans ? Alék avait fini par prendre des cours. Il était un habitué de ce genre de lieux. Il pouvait se déplacer un dimanche après-midi dans le 18ème. C’est dire. On y rencontre toujours, je ne sais pas pour quoi, le même type de femme : maigre, 1m65, poitrine sans matières grasses, cheveux châtain clair. Elles étaient là ce soir : habit noir en dentelle, sans décolleté, bras nus, escarpin talon haut, noir.
On changeait de tout au tout pour la salsa. Estivales, décontractées, les femmes étaient plus désinvoltes. On sortait du petit cercle d’initiés — tu sais, si tu ne sais pas danser elles te refusent… m’expliquera Aléx.
le rythme de salsa que je commence à entendre (mon choix était fait) me rappelle ce quelqu’un de joyeux, comme dirait maman, que je suis. Qu’est ce qui doit m’arriver pour que je me trouve dans cet état si piteux, hombre por Dios ! Si la peinture et le dessin étaient pour moi quelque chose jubilatoire, pour quoi diable je sombrais si facilement dans cette tristesse qui m’allait si mal, si peu moi. Il y avait, là, un mystère. Enfant par exemple, j’étais polisson, mais voilà qu’un jour… Rideau. Pour quoi ? Naciendo qué delito cometí…
alors — qu’est-ce qui me rendait si peu d’aplomb ? Un beau jour je me suis trouvé dans un labyrinthe, pour quoi ? Je pensais au poème de Jean de la Croix : entréme donde no supe…
j’y entrai sans savoir où… Je regardai les gens on me disant que peut-être la question était bien plus simple de ce que je ne pouvais l’imaginer. Il suffirait d’un peu plus d’entrain — qu’est-ce qui m’arrêtait ?
(Je revis l’homme du musée, une grimace me gela le visage, je fis un geste de la main, tout en secouant la tête et me tournai vers Alek)
— Ca a l’air d’être une fête privée ?
Il regarde les pacs des bières qui avaient un peu partout, et s’abaisse pour en prendre une et me l’offrir, et puis refait le geste pour prendre la sienne et après une brève gorgée me dit
— Je vais faire un tour à côté,
je le vois s’éloigner, puis je reviens sur la piste : les ombres des gens et des arbres projetaient sur le fond se mettent à bouger, je me retourne : c’est un bateau mouche. Je prends conscience que nous sommes au niveau de la Seine, et que moi-même je suis à quelque pas de l’eau. Le bateau mouche s’éloigne en direction du pont d’Austerlitz. Je fixe l’eau, j’essaie de savoir quelle est la couleur qui, là, s’y reflète, mais c’est impossible, je m’approche davantage : une modulation serpentine, le reflet lumineux des réverbères, mais l’eau, la couleur supposée de l’eau, ce vert opaque et délavé qu’on voit le jour, semblait englouti par le noir, le gris… Je ne me sens pas très bien, à deux doigts d’éprouver du vertige. Je revois l’ombre des arbres et des gens défiler sur le mur ; je me ressaisis. Un temps. Ma vue a du mal à fixer, un déséquilibre qui m’oblige à regarder le sol pour savoir où je marche. Je lève ma tête : étoffe blanche, du lin peut-être, une silhouette qui se détache du reste. Ses mouvements, qui demeurent quelques secondes de plus dans ma rétine comme s’ils étaient corroborés par des images au fond de moi. La reconnaissance d’une danse, des gestes précis, une souplesse que je connais, reconnais. Je reviens sur la silhouette, et je la vois… qui semble venir de l’arrière et passer devant, et en même temps, à partir de là où elle est viser cet amont. Ce n’est pas du lin c’est un tee-shirt blanc, seul le pantalon est en lin ; sa silhouette est plus dessinée, grande, svelte, un corps charpenté, elle ne doit pas être française : sa manière de danser, son visage, ses cheveux… elle fléchit ses jambes, s’amuse, rit, danse toute seule ; j’ai déjà entendu les paroles de cette chanson, je reconnais la voix de cette femme, je me garde de traduire, deux mondes parallèles que je ne veux pas interrompre, j’ignore où est le contrepoint ; je regarde à nouveau la Seine, j’entends le battement de la percussion pour la première fois : pulsations de congas — on commence par appuyer ses pieds au sol autrement que d’habitude, souplesse, un léger pas a côté, le rythme doit se réfléchir sur les hanches, un appel, un oubli, quand mon regard revient sur la piste, mes pieds ont épousé le rythme, je ne pourrai plus m’en défaire, surtout parce que maintenant c’est un merengue, cette voix aussi déjà entendue, moviendo la cadera, moviendo la cadera
une élasticité plus grande de l’espace et du temps, une autre façon de se rapporter à la vie — qu’est-ce que je me suis dit ?
je ne sais pas, je me souviens seulement d’avoir réfléchi la tête vide, les yeux vide, les mains vides ; je me suis dit quelque chose, ça oui, j’ai aussi décidé quelque chose ; mais quoi au juste ? je ne sais pas. Un blanc. Aussi blanc que le lin. Ensuite, avant de revenir à moi, je me suis souvenu de l’anniversaire de Nathan, le mois dernier, nous avions dansé toute la nuit… des sons qui se sont fondus avec la musique, la voix, azuquita, azuquita, de Célia que je commençai à entendre
quelqu’un me touche le bras, c’est Alek,
— Alors, c’était bien ?
— Oui, mais il y avait trop de monde. Et toi, tu ne danses pas ?
— Bientôt, je lui réponds sans quitter ma vue de la piste.
On s’assoit sur les gradins. Avec cérémonie je sors mon tabac et me roule une cigarette.
— Ca va ? Me demande Alék.
— Je crois.
Un temps se passe sans que nous nous parlions. Je ne la perds pas de vue. Elle danse seule et de manière continue, sans égard pour ce qui l’entoure. J’imagine un axe interne autour de quoi elle gravite, un rythme simultané à celui de la musique qui sort de la chaîne hi-fi. Je fais un signe du doigt en sa direction, qu’Alék comprend aussitôt
— Oui…
— Elle doit être vénézuélienne, non ?
Alék ébauche un sourire avant de me dire :
—Vas-y !
…ojala que llueva café, la voix de Juan Luis Guerra, on se lève. Je vois l’ensemble des corps qui dansent décrire une seule vague. Je regarde encore une fois vers la Seine, puis je tourne mon regard vers le Pont par où nous sommes descendus : des gens accoudés qui nous regardent ; je m’imagine ce que ça doit être vu de là bas. J’ai l’impression de tourner dans un film,
ojala que el otoño en vez de hojas secas… je la cherche… je ne la vois plus — où est-elle ? Mon regard ballait la piste, je me crispe un peu… Je vois un bus, Santiago, je cours après lui, je cours jusqu’au feu rouge, je fais signe au conducteur… — Mais où est-elle ?
un son que j’ai du mal situer, percussion, soit, mais d’où ? Afro-cubaine ? Irakéré ? Non. J’attends que la musique s’affirme… Dans le bus, je suis dans le bus, il fait très chaud ; nous venons d’une manif… Elle a du partir… Non. La musique est brésilienne, afro- brésilienne… Elle est là assise du côté de la fenêtre, elle ne m’a pas vu monter, je m’approche encore un peu plus
— Podemos bailar ?
elle acquiesce de la tête ; ce n’est pas de la samba, la percussion est plus proche des Caraïbes, plus afro-quelque-chose mais que je n’arrive pas à la situer ; je me surprends à être là, sans savoir comment. Il y a quelques minutes seulement il me semblait impossible pouvoir danser avec elle, et me voilà. Je ne sais pas comment. Un décalage mais fait sentir que ne suis nulle part et que cette musique m’enivre. Donnez le rythme d’une nuit, laissez-moi le dire sans que je parle… tengo visa para un sueño, le merengue revient, j’ai le temps de lui dire — de dónde vienes ? son regard est incrédule, elle recule d’un pas pour déclarer forfait, alors je comprends, et lui dis — Tu ne parle pas espagnol ? Elle fait non de sa tête, à ma question — d’où viens-tu ? elle répond — Je suis allemande, et j’éclate de rire ; dépitée, elle s’arrête, je lui dis de ne pas s’inquiéter, seulement que la voyant danser j’ai pensé… elle rit aussi et fait un geste entre naïf et coquin avec ses bras qu’elle plie vers elle, ses épaules qui montent et sa tête qui penche à droite, un désolée… qui m’attendri, et c’est le courrant qui passe, c’est l’instant ou quelque chose bascule, rien de très précis, un bien-être sans plus
à partir de là le temps n’est plus le même, à ce demande si c’es du temps. Le temps aura été mon grand « problème » – quelque chose que je n’ai jamais su ; et non parce que le temps soit le problème, où l’horizon, c’est, il me semble, que je n’ai jamais réussi à y être, dans le temps, encore moins dans les temps, et à nouveau cette attente, moi enfant, comme si j’avais été mis en marge, et à nouveau le bus… un quelconque de mes rêves, et cette parole que je porte en moi, différée, tacite, et pour laquelle je ne trouve pas le temps, je ne trouve pas de temps, de temps qui soit verbale, c’est-à-dire, qui se déclinant ait cette effet d’une présence qui soit la mienne — pages que j’écris en marchant, lectures faites, promenades, restant persuadé que si mon problème est le temps, le problème n’est pas le temps, la rançon est un effet muet que l’on porte et qui m’éloigne de tout commerce, performance, ou que sais-je, et non pas que ce choix ait d’abord été mien, il y a comme un début de phrases dont j’ignore l’entame, je veux dire que je n’est pas contenu dans celle-ci, comme le gland contient le chêne, et je me demande comment font les autres et c’est pour ça que la musique me soulage, Johnny Hodges n’est pas contenu dans Mood Indigo, il y va, lui, je suis sur qu’il y va, et je danse, quisiera ser un pez, tout ce à quoi je ne pense pas est compris dans la danse, comme la France comprend Paris, et Paris le Port de la Tournelle, mais c’est le Pont de la Tournelle qui est dans Paris, comme Mozart est dans Haydn
je vois qu’Alék s’est mis à danser lui aussi ; il y a un peu plus de monde que tout à l’heure. On a du mal à se déplacer, ça nous rapproche, nos phrases sont courtes. Nous ne cessons pas de danser. Je ne vois pas le temps passer. Plus tard, Alék viendra me dire qu’il s’en va pour ne pas rater le dernier Métro, je lui dirai que je reste un tout petit peu
je ne sais pas l’heure qu’il est quand la musique s’arrête, nous marchons un peu sans quitter le Port, puis nous nous assaillons sur un banc, nous entendons enfin nos voix respectives, elle parle très bien français. Nous avons tout le deux besoin de causer. J’apprendrai qu’elle a vécu à Paris, autrefois, qu’elle vient pour le wek-end, un coup de tête, avec une amie, elle me dira parce qu’elle est en train de divorcer et que c’est triste, qu’elle n’en pouvait plus — c’est surtout, me dira-t-elle, de voir comment les personnes changent, c’est très moche, ja, tu as du mal à croire que tu a vécu avec cette personne, puis tous ces problèmes avec l’avocat. C’est très moche, et toi, tu es marié ?
— Oui. Nous vivons aussi un moment difficile, mais pas dans le même sens.
— Tu as des enfants ?
— Non, pas pour le moment. Là, elle est en vacances, je suis à la maison, mais j’ai pris une chambre pour quand elle revienne. Nous allons nous séparer pendant un moment, mais, nous ne sommes pas fâché ni rien, c’est pour nous préserver, pour éviter de détruire… tu sais, je ne dors plus, bon, elle vient de finir ses études, la balle est dans mon camp. Je dois écrire un livre. Voir pour la suite. Il m’est difficile de dire ce que je vis. C’est comme un cauchemar réveillé. Mais j’ai horreur de parler comme ça.
— Pour quoi ?
— Parce que ça ne veut rien dire. Tu aimes la peinture ?
— Oui, bien sûr.
— J’ai un tableau ici, tu sais, ce tableau, voilà, il me faut ce tableau, ah ! mais je sais pas le dire, c’est impossible de le dire pour que tu le comprennes, la peinture et bien, je ne sais pas s’il y a de la peinture, pour moi, non… c’est pas la peine, parlons d’autre chose. Et toi, tu fais quoi dans la vie ?
— Je travail pour la télévision à Munich, je dois organiser des soirées, non mais c’est interne, des réceptions... J’ai fait une partie de mes études à Paris tu sais, oui, de la littérature. Je sais, ça n’a rien à voir avec ce que je fais maintenant…
notre conversation commença alors à bifurquer, pour nous éloigner de là où étions, sachant qu’il était inutile d’en parler, et plus encore qu’il était probablement un mensonge que de se parler ainsi, parce que nous étions là, tout bêtement là, et qu’il devait y avoir quelque chose d’équivalent à la danse, comme dire avec joie ce que nous aimions, ou ne rien dire, et nous approcher de ce silence qui reconnaît la présence de quelqu’un et arrête le bavardage, parce qu’avec deux ou trois mots nous savions l’essentiel ; nous étions là, ni l’un ni l’autre avait envie de partir, et c’est peut-être cela qui nous fit nous regarder vraiment, et que je puisse lui tendre ma main pour lui caresser le visage, et qu’elle vienne placer ses lèvres sur mes doigts, et ensuite que je place ma tête entre ses jambes et que je lève mes deux bras et qu’elle se penche sur moi jusqu’au baiser
je ne sais pas combien de temps dû s’écouler avant que je ne me rende compte qu’il commençait à faire jour — l’aube, je lui dis tout en levant mon bras, l’aube, c’est mon heure, d’abord il y a quatre heures du matin, c’est l’heure à la quelle tu entends les premiers gazouillements des oiseaux, si, si j’ai fais plusieurs fois le constat, quatre heures, puis il y a cet autre instant, quand je me rends compte que les rideaux ont changé de couleur, l’aube, c’est important, non ?
quand nous nous quittâmes il devait être sept heures du matin, un 14 juillet, et rentrais pour écrire
« il y des gestes dont la matérialité est beaucoup plus forte, je veux dire puissante, que le souvenir à partir duquel nous essayons de penser ce que nous avons vécu ; un dessin est plus juste, l’écriture est plus certaine, là, je peux retrouver par réflexion le renvoi d’une joie qui demeure, et au lieu de prendre congés des heures passées en y pensant, veiller : des effets tardives qui viendront ordonner les couleurs du paysage d’une manière inédites — tresses d’ombres et tons diffus imbriqués autrement qu’ils ne l’étaient par le passé, ( j’avais déjà associé les dessins de Watteau à Spinoza) »
jamais revue depuis, Cassandra.
J’ai pris le vélos pour m’y rendre, c’était un peu comme revenir au monde. Je m’étais douché, je lui arrivais avec un polo blanc, pantalon beige. Parfumé. Il me manquait le Panama et les années 30.
En effet, il y avait comme deux sortes de trous : des cercles avec des gradins en dessous le niveau du sol. Dans l’un les gens dansaient le tango et dans l’autre la salsa. Deux ambiances complètement différentes, la première trop guindée, des gens en tenue, sérieuses, trop, quand on pense que c’était une danse des bas-fonds à Buenos-Aires, où l’homme est un maffieux et la femme une pute… Une pose de cours de danse, femmes célibataires du 16ème ? Je ne comprenais pas — quel intérêt trouvait-il là-dedans ? Alék avait fini par prendre des cours. Il était un habitué de ce genre de lieux. Il pouvait se déplacer un dimanche après-midi dans le 18ème. C’est dire. On y rencontre toujours, je ne sais pas pour quoi, le même type de femme : maigre, 1m65, poitrine sans matières grasses, cheveux châtain clair. Elles étaient là ce soir : habit noir en dentelle, sans décolleté, bras nus, escarpin talon haut, noir.
On changeait de tout au tout pour la salsa. Estivales, décontractées, les femmes étaient plus désinvoltes. On sortait du petit cercle d’initiés — tu sais, si tu ne sais pas danser elles te refusent… m’expliquera Aléx.
le rythme de salsa que je commence à entendre (mon choix était fait) me rappelle ce quelqu’un de joyeux, comme dirait maman, que je suis. Qu’est ce qui doit m’arriver pour que je me trouve dans cet état si piteux, hombre por Dios ! Si la peinture et le dessin étaient pour moi quelque chose jubilatoire, pour quoi diable je sombrais si facilement dans cette tristesse qui m’allait si mal, si peu moi. Il y avait, là, un mystère. Enfant par exemple, j’étais polisson, mais voilà qu’un jour… Rideau. Pour quoi ? Naciendo qué delito cometí…
alors — qu’est-ce qui me rendait si peu d’aplomb ? Un beau jour je me suis trouvé dans un labyrinthe, pour quoi ? Je pensais au poème de Jean de la Croix : entréme donde no supe…
j’y entrai sans savoir où… Je regardai les gens on me disant que peut-être la question était bien plus simple de ce que je ne pouvais l’imaginer. Il suffirait d’un peu plus d’entrain — qu’est-ce qui m’arrêtait ?
(Je revis l’homme du musée, une grimace me gela le visage, je fis un geste de la main, tout en secouant la tête et me tournai vers Alek)
— Ca a l’air d’être une fête privée ?
Il regarde les pacs des bières qui avaient un peu partout, et s’abaisse pour en prendre une et me l’offrir, et puis refait le geste pour prendre la sienne et après une brève gorgée me dit
— Je vais faire un tour à côté,
je le vois s’éloigner, puis je reviens sur la piste : les ombres des gens et des arbres projetaient sur le fond se mettent à bouger, je me retourne : c’est un bateau mouche. Je prends conscience que nous sommes au niveau de la Seine, et que moi-même je suis à quelque pas de l’eau. Le bateau mouche s’éloigne en direction du pont d’Austerlitz. Je fixe l’eau, j’essaie de savoir quelle est la couleur qui, là, s’y reflète, mais c’est impossible, je m’approche davantage : une modulation serpentine, le reflet lumineux des réverbères, mais l’eau, la couleur supposée de l’eau, ce vert opaque et délavé qu’on voit le jour, semblait englouti par le noir, le gris… Je ne me sens pas très bien, à deux doigts d’éprouver du vertige. Je revois l’ombre des arbres et des gens défiler sur le mur ; je me ressaisis. Un temps. Ma vue a du mal à fixer, un déséquilibre qui m’oblige à regarder le sol pour savoir où je marche. Je lève ma tête : étoffe blanche, du lin peut-être, une silhouette qui se détache du reste. Ses mouvements, qui demeurent quelques secondes de plus dans ma rétine comme s’ils étaient corroborés par des images au fond de moi. La reconnaissance d’une danse, des gestes précis, une souplesse que je connais, reconnais. Je reviens sur la silhouette, et je la vois… qui semble venir de l’arrière et passer devant, et en même temps, à partir de là où elle est viser cet amont. Ce n’est pas du lin c’est un tee-shirt blanc, seul le pantalon est en lin ; sa silhouette est plus dessinée, grande, svelte, un corps charpenté, elle ne doit pas être française : sa manière de danser, son visage, ses cheveux… elle fléchit ses jambes, s’amuse, rit, danse toute seule ; j’ai déjà entendu les paroles de cette chanson, je reconnais la voix de cette femme, je me garde de traduire, deux mondes parallèles que je ne veux pas interrompre, j’ignore où est le contrepoint ; je regarde à nouveau la Seine, j’entends le battement de la percussion pour la première fois : pulsations de congas — on commence par appuyer ses pieds au sol autrement que d’habitude, souplesse, un léger pas a côté, le rythme doit se réfléchir sur les hanches, un appel, un oubli, quand mon regard revient sur la piste, mes pieds ont épousé le rythme, je ne pourrai plus m’en défaire, surtout parce que maintenant c’est un merengue, cette voix aussi déjà entendue, moviendo la cadera, moviendo la cadera
une élasticité plus grande de l’espace et du temps, une autre façon de se rapporter à la vie — qu’est-ce que je me suis dit ?
je ne sais pas, je me souviens seulement d’avoir réfléchi la tête vide, les yeux vide, les mains vides ; je me suis dit quelque chose, ça oui, j’ai aussi décidé quelque chose ; mais quoi au juste ? je ne sais pas. Un blanc. Aussi blanc que le lin. Ensuite, avant de revenir à moi, je me suis souvenu de l’anniversaire de Nathan, le mois dernier, nous avions dansé toute la nuit… des sons qui se sont fondus avec la musique, la voix, azuquita, azuquita, de Célia que je commençai à entendre
quelqu’un me touche le bras, c’est Alek,
— Alors, c’était bien ?
— Oui, mais il y avait trop de monde. Et toi, tu ne danses pas ?
— Bientôt, je lui réponds sans quitter ma vue de la piste.
On s’assoit sur les gradins. Avec cérémonie je sors mon tabac et me roule une cigarette.
— Ca va ? Me demande Alék.
— Je crois.
Un temps se passe sans que nous nous parlions. Je ne la perds pas de vue. Elle danse seule et de manière continue, sans égard pour ce qui l’entoure. J’imagine un axe interne autour de quoi elle gravite, un rythme simultané à celui de la musique qui sort de la chaîne hi-fi. Je fais un signe du doigt en sa direction, qu’Alék comprend aussitôt
— Oui…
— Elle doit être vénézuélienne, non ?
Alék ébauche un sourire avant de me dire :
—Vas-y !
…ojala que llueva café, la voix de Juan Luis Guerra, on se lève. Je vois l’ensemble des corps qui dansent décrire une seule vague. Je regarde encore une fois vers la Seine, puis je tourne mon regard vers le Pont par où nous sommes descendus : des gens accoudés qui nous regardent ; je m’imagine ce que ça doit être vu de là bas. J’ai l’impression de tourner dans un film,
ojala que el otoño en vez de hojas secas… je la cherche… je ne la vois plus — où est-elle ? Mon regard ballait la piste, je me crispe un peu… Je vois un bus, Santiago, je cours après lui, je cours jusqu’au feu rouge, je fais signe au conducteur… — Mais où est-elle ?
un son que j’ai du mal situer, percussion, soit, mais d’où ? Afro-cubaine ? Irakéré ? Non. J’attends que la musique s’affirme… Dans le bus, je suis dans le bus, il fait très chaud ; nous venons d’une manif… Elle a du partir… Non. La musique est brésilienne, afro- brésilienne… Elle est là assise du côté de la fenêtre, elle ne m’a pas vu monter, je m’approche encore un peu plus
— Podemos bailar ?
elle acquiesce de la tête ; ce n’est pas de la samba, la percussion est plus proche des Caraïbes, plus afro-quelque-chose mais que je n’arrive pas à la situer ; je me surprends à être là, sans savoir comment. Il y a quelques minutes seulement il me semblait impossible pouvoir danser avec elle, et me voilà. Je ne sais pas comment. Un décalage mais fait sentir que ne suis nulle part et que cette musique m’enivre. Donnez le rythme d’une nuit, laissez-moi le dire sans que je parle… tengo visa para un sueño, le merengue revient, j’ai le temps de lui dire — de dónde vienes ? son regard est incrédule, elle recule d’un pas pour déclarer forfait, alors je comprends, et lui dis — Tu ne parle pas espagnol ? Elle fait non de sa tête, à ma question — d’où viens-tu ? elle répond — Je suis allemande, et j’éclate de rire ; dépitée, elle s’arrête, je lui dis de ne pas s’inquiéter, seulement que la voyant danser j’ai pensé… elle rit aussi et fait un geste entre naïf et coquin avec ses bras qu’elle plie vers elle, ses épaules qui montent et sa tête qui penche à droite, un désolée… qui m’attendri, et c’est le courrant qui passe, c’est l’instant ou quelque chose bascule, rien de très précis, un bien-être sans plus
à partir de là le temps n’est plus le même, à ce demande si c’es du temps. Le temps aura été mon grand « problème » – quelque chose que je n’ai jamais su ; et non parce que le temps soit le problème, où l’horizon, c’est, il me semble, que je n’ai jamais réussi à y être, dans le temps, encore moins dans les temps, et à nouveau cette attente, moi enfant, comme si j’avais été mis en marge, et à nouveau le bus… un quelconque de mes rêves, et cette parole que je porte en moi, différée, tacite, et pour laquelle je ne trouve pas le temps, je ne trouve pas de temps, de temps qui soit verbale, c’est-à-dire, qui se déclinant ait cette effet d’une présence qui soit la mienne — pages que j’écris en marchant, lectures faites, promenades, restant persuadé que si mon problème est le temps, le problème n’est pas le temps, la rançon est un effet muet que l’on porte et qui m’éloigne de tout commerce, performance, ou que sais-je, et non pas que ce choix ait d’abord été mien, il y a comme un début de phrases dont j’ignore l’entame, je veux dire que je n’est pas contenu dans celle-ci, comme le gland contient le chêne, et je me demande comment font les autres et c’est pour ça que la musique me soulage, Johnny Hodges n’est pas contenu dans Mood Indigo, il y va, lui, je suis sur qu’il y va, et je danse, quisiera ser un pez, tout ce à quoi je ne pense pas est compris dans la danse, comme la France comprend Paris, et Paris le Port de la Tournelle, mais c’est le Pont de la Tournelle qui est dans Paris, comme Mozart est dans Haydn
je vois qu’Alék s’est mis à danser lui aussi ; il y a un peu plus de monde que tout à l’heure. On a du mal à se déplacer, ça nous rapproche, nos phrases sont courtes. Nous ne cessons pas de danser. Je ne vois pas le temps passer. Plus tard, Alék viendra me dire qu’il s’en va pour ne pas rater le dernier Métro, je lui dirai que je reste un tout petit peu
je ne sais pas l’heure qu’il est quand la musique s’arrête, nous marchons un peu sans quitter le Port, puis nous nous assaillons sur un banc, nous entendons enfin nos voix respectives, elle parle très bien français. Nous avons tout le deux besoin de causer. J’apprendrai qu’elle a vécu à Paris, autrefois, qu’elle vient pour le wek-end, un coup de tête, avec une amie, elle me dira parce qu’elle est en train de divorcer et que c’est triste, qu’elle n’en pouvait plus — c’est surtout, me dira-t-elle, de voir comment les personnes changent, c’est très moche, ja, tu as du mal à croire que tu a vécu avec cette personne, puis tous ces problèmes avec l’avocat. C’est très moche, et toi, tu es marié ?
— Oui. Nous vivons aussi un moment difficile, mais pas dans le même sens.
— Tu as des enfants ?
— Non, pas pour le moment. Là, elle est en vacances, je suis à la maison, mais j’ai pris une chambre pour quand elle revienne. Nous allons nous séparer pendant un moment, mais, nous ne sommes pas fâché ni rien, c’est pour nous préserver, pour éviter de détruire… tu sais, je ne dors plus, bon, elle vient de finir ses études, la balle est dans mon camp. Je dois écrire un livre. Voir pour la suite. Il m’est difficile de dire ce que je vis. C’est comme un cauchemar réveillé. Mais j’ai horreur de parler comme ça.
— Pour quoi ?
— Parce que ça ne veut rien dire. Tu aimes la peinture ?
— Oui, bien sûr.
— J’ai un tableau ici, tu sais, ce tableau, voilà, il me faut ce tableau, ah ! mais je sais pas le dire, c’est impossible de le dire pour que tu le comprennes, la peinture et bien, je ne sais pas s’il y a de la peinture, pour moi, non… c’est pas la peine, parlons d’autre chose. Et toi, tu fais quoi dans la vie ?
— Je travail pour la télévision à Munich, je dois organiser des soirées, non mais c’est interne, des réceptions... J’ai fait une partie de mes études à Paris tu sais, oui, de la littérature. Je sais, ça n’a rien à voir avec ce que je fais maintenant…
notre conversation commença alors à bifurquer, pour nous éloigner de là où étions, sachant qu’il était inutile d’en parler, et plus encore qu’il était probablement un mensonge que de se parler ainsi, parce que nous étions là, tout bêtement là, et qu’il devait y avoir quelque chose d’équivalent à la danse, comme dire avec joie ce que nous aimions, ou ne rien dire, et nous approcher de ce silence qui reconnaît la présence de quelqu’un et arrête le bavardage, parce qu’avec deux ou trois mots nous savions l’essentiel ; nous étions là, ni l’un ni l’autre avait envie de partir, et c’est peut-être cela qui nous fit nous regarder vraiment, et que je puisse lui tendre ma main pour lui caresser le visage, et qu’elle vienne placer ses lèvres sur mes doigts, et ensuite que je place ma tête entre ses jambes et que je lève mes deux bras et qu’elle se penche sur moi jusqu’au baiser
je ne sais pas combien de temps dû s’écouler avant que je ne me rende compte qu’il commençait à faire jour — l’aube, je lui dis tout en levant mon bras, l’aube, c’est mon heure, d’abord il y a quatre heures du matin, c’est l’heure à la quelle tu entends les premiers gazouillements des oiseaux, si, si j’ai fais plusieurs fois le constat, quatre heures, puis il y a cet autre instant, quand je me rends compte que les rideaux ont changé de couleur, l’aube, c’est important, non ?
quand nous nous quittâmes il devait être sept heures du matin, un 14 juillet, et rentrais pour écrire
« il y des gestes dont la matérialité est beaucoup plus forte, je veux dire puissante, que le souvenir à partir duquel nous essayons de penser ce que nous avons vécu ; un dessin est plus juste, l’écriture est plus certaine, là, je peux retrouver par réflexion le renvoi d’une joie qui demeure, et au lieu de prendre congés des heures passées en y pensant, veiller : des effets tardives qui viendront ordonner les couleurs du paysage d’une manière inédites — tresses d’ombres et tons diffus imbriqués autrement qu’ils ne l’étaient par le passé, ( j’avais déjà associé les dessins de Watteau à Spinoza) »
jamais revue depuis, Cassandra.
Manuscrit jazz quartet 03/1Partie
Je redescends le lendemain. J’avais pris soin de ne pas remettre le manuscrit dans le carton. Nouvelle recherche. Il n’y a pas de pages tapées. Je lis un peu…
Manus/III/c,da
1er octobre —
et que ma plume vienne et que ce soit l’encre le vent, lent le vin vient de loin le vent, que l’encre imite l’air et l’argile, et qu’en dessous le silence, si le silence est un bien, me conduise jusqu’au chant, demain je réécouterai Haydn, et Mozart dans Haydn, le fils dans le père
j’ai fait un rêve d’une étrange sobriété, c’était pourtant un cauchemar — la version étouffée d’une voix : je rentrais dans une salle, plusieurs personnes se trouvaient là sans qu’aucune fut présente, des murs de bois revêtus d’étagères, des livres anciens, une longue table ; j’écoutais la voix qui ne s’entendait pas et ce silence dont l’autorité me sommait de m’expliquer. J’ai pris alors la parole, sans que personne fut, ils étaient tous à m’écouter en demi-cercle ; ce que je disais se dissolvait dans l’air, en retour on entendait un cri étouffé, aphone, et plus j’avançais dans mon discours plus ma voix devenait inaudible, pris de panique j’indiquais vers le fond de la salle où une terre cuite du Bernin s’y trouvait. Je m’en approche, quand je veux la prendre, elle disparaît. Je reste là, les bras levés et béants, pourtant je sens son poids et regrette seulement de ne pas avoir de la terre glaise pour la refaire, c’est alors que j’entends des rires autours de moi, je regarde le sol, ébahi et déconfit,
que ma plume vienne sous l’encre envelopper et rompre le jour qui n’est pas, ne fut pas et ne fut plus, je marchais, j’allais vers l’endroit d’où ma parole était partie, il y avait une fenêtre très en haut, un rayon la traversait et allait se projeter dans le mur d’en face : courbe d’orge sur le bois ; je vois une poussière d’un gris bleuté dans l’air s’agiter, quelque chose de corpusculaire et instable qui reproduit la trajectoire du rayon, milles éclaboussures se croiser dans l’air; sans m’arrêter de marcher je commence alors à réciter ce long poème de Lucrèce en son quatrième livre, ce mêlait à cette scène le souvenir, plus ancien, d’une cuisine à la campagne : la maison de l’oncle maternel, là aussi il y avait en haut une fenêtre que j’allais épier quand tout le monde faisait la sieste, vers trois ou quatre heures de l’après-midi, je regardais ce bleu poussiéreux s’agiter, et entendais graviter autour, et se poser ça et là, des mouche qui bourdonnaient ; l’air qui m’était toujours paru transparente et vide me dévoilaient son monde infime, là, dans ce faisceau qui était comme une fumée sans arabesques — mais comment pouvais-je réciter ce poème que je ne connaissais pas par cœur ? voilà qui était invraisemblable, pourtant je reconnaissais bien cette quatrième partie du livre qui commençait par : Des Piérides je parcours les lointaines contrées que nul n’explora — preuve de que je rêve, je me disais dans le rêve,
Chemise, sous chemise. Le choix d’une couleur. Je continue à écrire par en dessous, sans faire exprès. Feuilles jaunes. En réalité c’est un ocre-sable que j’avais choisi pour écrire.
Jonquilles. Deux frères les vendaient à la sortie d’un parc de stationnement où elle est venue garer la voiture. Couleur. La couleur qui représente le chemin que j’étais en voie de tracer. J’avais travaillé sur le rouge, je séjournais dans le jaune ; il me restait le bleu : je me couchais à l’aube. C’était un moment difficile, je ne voyais pas d’issue en dehors de cette patience que je m’inventais — jours et choses vues devenaient par bribes, ici ou là, une trouée par où je pouvais m’échapper un instant, respirer
Je n’avais d’autre lieu que les fables que je pouvais inventer.
Commet suis-je arrivé à me dire que le Musée était mon labyrinthe ?
— je ne comprenais pas pourquoi, au lieu de me conduire à bon port, mes efforts se retournaient contre moi, comme si par le truchement d’un disfonctionnement interne, ce qui devait m’indiquer la sortie, cela même m’en éloignait. Ainsi tous les acquis de mes nombreuses lectures avaient autant de raison d’être la source d’une joie extrême, que je vivais, comme la cause de mon désarroi. Il m’était possible de réaliser des progrès notables mais pas de leur donner existence, et cet écart qui pour mon intelligence avait ses attraits, dans ma vie de couple était un abîme qui me faisait souffrir. Tout espoir retardé, je ne dormais plus la nuit.
D’abord fut l’aube, voyais pointer le petit jour. J’écrivais le peu d’un plus. J’étais dans un labyrinthe. Le Louvre était ce labyrinthe. Mais le Louvre était aussi un jardin. Il suffisait de trouver la clé
notre cerveau enregistre les couleurs au gré d’une façon qui nous caractérise ; se crée en nous une sorte de carte pour ne pas dire de tableau qui, si chacun pouvait le projeter dehors, serait l’équivalent d’une empreinte digitale ou d’iris. Unique. Ajoutons qu’à cela puissent venir se greffer les jours simples de notre vie. Ainsi j’ai vu ces deux frères s’improviser un métier pour gagner quelques sous un mois de mai, et ces jonquilles, que nous avions vu pousser librement dans les sous-bois du château de Chantilly, venir à ma rencontre — cet ami qui nous fait signe
Comme il était improbable que je puisse partager ce moment en le lui expliquant, (nous nous étions garé là parce qu’elle voulait aller aux toilettes) quand elle est revenue du restaurant je les avais déjà à la main pour les lui offrir. Cela et d’autres gestes de même nature allaient partir en éclats ce jour de septembre.
c’était un signal,je devais me souvenir de quelque chose, j’avais par le passé lu cette partie à haute voix, comme j’aimais réciter Empédocle et comme je m’appliquais à lire les premières pages de Finnegans Wake, mais je ne les apprenais pas par cœur ; ce rêve, (dans le rêve j’étais conscient que je rêvais) il m’avertissait : je voulais dire quelque chose à quelqu’un mais les amarres lâchaient, les dédales se multipliaient, ce poème était là, pour le rêveur, comme un ultime recours, le dernier rempart, pour enrayer quelque chose,
le Bernin, quand j’ai voulu la prendre… un dimanche, il n’y a pas très longtemps, après avoir vu au Louvre : Véronèse et le Titien, la Bella Nina etc., me dirigeant vers la sortie, quelle ne fut ma surprise à la vue d’une terre cuite du Bernin, une Sainte couchée, que des souvenirs ; moi disant en aparté : je ne te le dirai pas, si tu ne le dis pas, je ne le dirai pas, je ne dirai rien…
le poème pendant que je le récitais était une trouée par où je pouvais descendre ; je remontais et refaisais surface, et ce malgré la salle comble et vide, ce qui est un comble pour une salle vide, où ces Messieurs attendaient mes explications, et moi, nulle voix qui sort,
Je ferme le dossier et vais au carton dans l’espoir de trouver ces pages tapées. Rien à nouveau. J’ouvre un dossier qui correspond au projet de livre. A l’intérieur se trouve décrite une promenade au Louvre, le début du livre que j’étais en train d’écrire.
L’Ecole du Nord… Mes promenades étaient magiques. Si d’un côté il y avait ce but que j’avais à atteindre, but que je déduisais non pas de la connaissance que j’avais de l’objectif (à vrai dire, je ne savais que peu de choses à ce sujet) mais de la fermeté avec laquelle je pouvais refuser les fausses pistes, de l’autre se trouvait ce plaisir que j’éprouvais à la vue d’un pont, des bouquinistes, d’un détail, des passants, des lumières que je comparais à celles des jours précédents. Je marchais lentement, si lentement que je donnais l’impression de n’aller nulle part.
Comme un paradoxe : si j’allais au Louvre, aucun de mes pas m’en approchait ; je n’avais pas encore atteint le Pont des Arts que je m’y trouvais déjà. Où que je fusse, la sensation était la même : se sentir expulsé de là où j’étais.
La solitude avait produit en moi une autre voix que celle dont on se sert pour parler. Ma méditation ne s’appuyait pas toujours sur des mots et pouvait, à l’occasion, éclore des couleurs perçues, la voix provenir de plusieurs endroits à la fois, et se maintenir dans une zone hybride. Comme cela avait lieu dans l’espace, j’avais l’impression de rester dans un lieu ajourné pour les autres. Moi-même, en dehors du moment, quand je rentrais et que j’essayais d’y penser, je me sentais séparé de mon bien, incapable de faire la synthèse. Pourtant j’écrivais, j’écrivais comme on part à la pêche, sans savoir… disons que je notais, je notais pour ce moment où il me serait possible de déchiffrer
à quinze ans je faisais, en bord de mer, des promenades avec cette même appréhension, chassé d’où j’étais, j’improvisais dans la marche, j’allais du côté de la maison de Ada, sans me présenter ni m’approcher de trop, j’avais réussi à produire un silence qui me servait de bouclier, j’étais comme un chiot, avec des cailloux à la main, je me sentais accompagné. Il y eut cette séparation dans ma vie, cette nécessité de me forger une voie en dehors des protocoles, une douce mélancolie, j’enrayais une agression qui allait jusqu’à dans mes rêves, c’était comme un message que je ne comprenais pas, qui m’était destiné, et que je ne comprenais pas.
C’est l’intuition qui forge nos premières armes. Il peut s’écouler un temps plus ou moins long avant de l’apprendre, nous pouvons désespérer de ne pas voir l’issue, pourtant, c’est dans les moments les plus difficiles que ce qui paraît se présenter sous le signe de l’infortune récupère le tracé d’un choix — un trait qui nous représente, qui nous fait tenir alors que tout le reste est en retrait, mais nous ne pouvons rien dire, et c’est normal qu’il en soit ainsi, car nous ne pouvons pas présenter ce qui nous représente, puisque ce lieu nous l’occupons ; un secret est désormais notre place, et cette place est incommunicable, une âme si par « âme » nous entendons la forme d’un corps
parfois je ne savais plus l’âge que j’avais ; le souvenir n’avait pas la marque d’un temps révolu, il était comme de la pluie qui tombe, un même son sur le bitume. Quand nous vivons une douleur, en abrégé nous récapitulons les chagrins qui lui on précédé, ce sont eux qui façonnent la manière que nous avons de sentir, ou d’accorder plus d’importance à ceci plutôt qu’à cela, le temps est une denrée qui s’ajute avec le deuil et l’oubli, mais d’abord c’est le même chiffre frappe la peau du tambour,
chose je n’ai jamais osé dire à personne…
… lors d’une de mes promenades, il arriva quelque chose qui me laissera dans le plus grand embarras… Je déambulais de salle en salle, mon trajet était irrégulier, je pouvais avancer sans regarder tableau puis m’attarder sur un détail ou me souvenir d’un autre, revenir sur mes pas pour vérifier mes sources. C’est lors d’un de ces changements de direction que j’ai la sensation, d’un côté, d’être suivi et, de l’autre, la certitude de que quelqu’un me suit. Un homme, dont je n’ai pas voulu voir ni visage ni rien, ni prêter attention par la suite ni vérifier mes soupçons. Rien. C’est arrivé quand j’ai voulu revenir sur un tableau qui se trouvait dans la salle que je venais de quitter, ne s’y attendant pas, l’homme afficha un sursaut et voulu se cacher se tournant vers le mur de clôture. Le geste était maladroit, et si évident que difficilement on pouvait lui attribuer une autre explication ; mais en même temps invraisemblable — qui pouvait bien me faire suivre ? Je croyais rentrer dans un cauchemar — alors là je suis foutu, fou à lier. Un terrain sablonneux où c’est la raison commence la besogne et la paranoïa qui la termine
J’eusse préféré ne pas y assister. Ma douleur fut intense et radical
mais comment dit-on ça quand trop de questions prennent lieu en un seul point et que le point éclate, s’étiole et part en milles morceaux ? Cela vous laisse à moitié ailleurs et ailleurs nulle part
pouvait être vrai, pouvait être faux, coïncidence avec quelque chose qui ne m’était pas destiné ? un concours de circonstances qui débouchait sur une certitude là où seule était vraie l’illusion ? comme ce manteau qui perché à l’entrée, quand on n’est pas prévenu nous fait croire à quelqu’un . Car qui pouvait bien me suivre ? Qui ?
Non ? Et si… non ? Je me refusais à admettre qu’à l’instigation de quelqu’un j’étais suivi. Les plus folles hypothèses. Non ? Crois-tu ? Une cascade de conjectures en roue libre. J’avais le souvenir d’une lecture de Sabato : le narrateur qui sans que nous ne nous rendions compte va passer du soupçon à la suspicion et de la suspicion à la certitude, basculer dans le délire : les aveugles sont une secte qui domine le monde,
non, je me trompais certainement. C’était mon état fébrile après tant de nuits blanches, travail dont je ne voyais pas le bout. Je savais ne pas avoir les moyens d’être certain de quoi que ce soit. La contrainte était double : si j’affirmais, je ne me laissais aucune chance de distinguer le vrai du faux, si je niais, je ne donnais plus de crédit à mes sens. J’étais nulle part. J’ai eu sommeil, mes yeux piquaient. C’était une intrusion dans ma vie privée. J’avais le vertige du seul fait d’y penser. Se dressaient autant de fantômes que des conversations j’avais avec moi-même. J’ai voulu oublier ce qui venait de se passer, mais c’était comme au billard, où une boule transmet le mouvement à l’autre… la cause n’était plus là où je l’avais rencontrée
mais comment dit-on ça quand trop de questions prennent lieu en un seul point et que le point éclate, s’étiole et part en milles morceaux ? Cela vous laisse à moitié ailleurs et ailleurs nulle part
comment allais-je faire maintenant ? ah ! mais je m’étais habitué à donner à ces divagations une matière plastique et musicale, elles pouvaient à tout moment laisser la place vacante. Des notions qui avaient le don de se succéder les unes aux autres. Je pouvais aussi bien les suivre d’après le vide que chacune laissait que l’étoffe qui était la leur — si vous pensez dans la langue, je disais, c’est aussi un manteau qui vous couvre, dans cette langue de tous les jours, dans cette manière de parler de tous les jours, dans cette manière imprécise de dire parce que chaque chose manque à sa place
soit, mais et si c’était vrai, et si quelqu’un… etc. Non, décidément s’en était trop… cela m’épuisait.
Une douleur chagrine restera dans l’air comme la seule chose viable. Je n’avais des tableaux que le souvenir d’une autre ville… Venise. Le jazz j’allais le rencontrer là même où j’avais suspendu mes visites, d’ailleurs, j’ignorais à l’époque que le Louvre allait me quitter pour un temps. Sept ou huit années. Let’s fall in love, Duke et Johnny en 1959.
Manus/III/c,da
1er octobre —
et que ma plume vienne et que ce soit l’encre le vent, lent le vin vient de loin le vent, que l’encre imite l’air et l’argile, et qu’en dessous le silence, si le silence est un bien, me conduise jusqu’au chant, demain je réécouterai Haydn, et Mozart dans Haydn, le fils dans le père
j’ai fait un rêve d’une étrange sobriété, c’était pourtant un cauchemar — la version étouffée d’une voix : je rentrais dans une salle, plusieurs personnes se trouvaient là sans qu’aucune fut présente, des murs de bois revêtus d’étagères, des livres anciens, une longue table ; j’écoutais la voix qui ne s’entendait pas et ce silence dont l’autorité me sommait de m’expliquer. J’ai pris alors la parole, sans que personne fut, ils étaient tous à m’écouter en demi-cercle ; ce que je disais se dissolvait dans l’air, en retour on entendait un cri étouffé, aphone, et plus j’avançais dans mon discours plus ma voix devenait inaudible, pris de panique j’indiquais vers le fond de la salle où une terre cuite du Bernin s’y trouvait. Je m’en approche, quand je veux la prendre, elle disparaît. Je reste là, les bras levés et béants, pourtant je sens son poids et regrette seulement de ne pas avoir de la terre glaise pour la refaire, c’est alors que j’entends des rires autours de moi, je regarde le sol, ébahi et déconfit,
que ma plume vienne sous l’encre envelopper et rompre le jour qui n’est pas, ne fut pas et ne fut plus, je marchais, j’allais vers l’endroit d’où ma parole était partie, il y avait une fenêtre très en haut, un rayon la traversait et allait se projeter dans le mur d’en face : courbe d’orge sur le bois ; je vois une poussière d’un gris bleuté dans l’air s’agiter, quelque chose de corpusculaire et instable qui reproduit la trajectoire du rayon, milles éclaboussures se croiser dans l’air; sans m’arrêter de marcher je commence alors à réciter ce long poème de Lucrèce en son quatrième livre, ce mêlait à cette scène le souvenir, plus ancien, d’une cuisine à la campagne : la maison de l’oncle maternel, là aussi il y avait en haut une fenêtre que j’allais épier quand tout le monde faisait la sieste, vers trois ou quatre heures de l’après-midi, je regardais ce bleu poussiéreux s’agiter, et entendais graviter autour, et se poser ça et là, des mouche qui bourdonnaient ; l’air qui m’était toujours paru transparente et vide me dévoilaient son monde infime, là, dans ce faisceau qui était comme une fumée sans arabesques — mais comment pouvais-je réciter ce poème que je ne connaissais pas par cœur ? voilà qui était invraisemblable, pourtant je reconnaissais bien cette quatrième partie du livre qui commençait par : Des Piérides je parcours les lointaines contrées que nul n’explora — preuve de que je rêve, je me disais dans le rêve,
Chemise, sous chemise. Le choix d’une couleur. Je continue à écrire par en dessous, sans faire exprès. Feuilles jaunes. En réalité c’est un ocre-sable que j’avais choisi pour écrire.
Jonquilles. Deux frères les vendaient à la sortie d’un parc de stationnement où elle est venue garer la voiture. Couleur. La couleur qui représente le chemin que j’étais en voie de tracer. J’avais travaillé sur le rouge, je séjournais dans le jaune ; il me restait le bleu : je me couchais à l’aube. C’était un moment difficile, je ne voyais pas d’issue en dehors de cette patience que je m’inventais — jours et choses vues devenaient par bribes, ici ou là, une trouée par où je pouvais m’échapper un instant, respirer
Je n’avais d’autre lieu que les fables que je pouvais inventer.
Commet suis-je arrivé à me dire que le Musée était mon labyrinthe ?
— je ne comprenais pas pourquoi, au lieu de me conduire à bon port, mes efforts se retournaient contre moi, comme si par le truchement d’un disfonctionnement interne, ce qui devait m’indiquer la sortie, cela même m’en éloignait. Ainsi tous les acquis de mes nombreuses lectures avaient autant de raison d’être la source d’une joie extrême, que je vivais, comme la cause de mon désarroi. Il m’était possible de réaliser des progrès notables mais pas de leur donner existence, et cet écart qui pour mon intelligence avait ses attraits, dans ma vie de couple était un abîme qui me faisait souffrir. Tout espoir retardé, je ne dormais plus la nuit.
D’abord fut l’aube, voyais pointer le petit jour. J’écrivais le peu d’un plus. J’étais dans un labyrinthe. Le Louvre était ce labyrinthe. Mais le Louvre était aussi un jardin. Il suffisait de trouver la clé
notre cerveau enregistre les couleurs au gré d’une façon qui nous caractérise ; se crée en nous une sorte de carte pour ne pas dire de tableau qui, si chacun pouvait le projeter dehors, serait l’équivalent d’une empreinte digitale ou d’iris. Unique. Ajoutons qu’à cela puissent venir se greffer les jours simples de notre vie. Ainsi j’ai vu ces deux frères s’improviser un métier pour gagner quelques sous un mois de mai, et ces jonquilles, que nous avions vu pousser librement dans les sous-bois du château de Chantilly, venir à ma rencontre — cet ami qui nous fait signe
Comme il était improbable que je puisse partager ce moment en le lui expliquant, (nous nous étions garé là parce qu’elle voulait aller aux toilettes) quand elle est revenue du restaurant je les avais déjà à la main pour les lui offrir. Cela et d’autres gestes de même nature allaient partir en éclats ce jour de septembre.
c’était un signal,
le Bernin, quand j’ai voulu la prendre… un dimanche, il n’y a pas très longtemps, après avoir vu au Louvre : Véronèse et le Titien, la Bella Nina etc., me dirigeant vers la sortie, quelle ne fut ma surprise à la vue d’une terre cuite du Bernin, une Sainte couchée, que des souvenirs ; moi disant en aparté : je ne te le dirai pas, si tu ne le dis pas, je ne le dirai pas, je ne dirai rien…
le poème pendant que je le récitais était une trouée par où je pouvais descendre ; je remontais et refaisais surface, et ce malgré la salle comble et vide, ce qui est un comble pour une salle vide, où ces Messieurs attendaient mes explications, et moi, nulle voix qui sort,
Je ferme le dossier et vais au carton dans l’espoir de trouver ces pages tapées. Rien à nouveau. J’ouvre un dossier qui correspond au projet de livre. A l’intérieur se trouve décrite une promenade au Louvre, le début du livre que j’étais en train d’écrire.
L’Ecole du Nord… Mes promenades étaient magiques. Si d’un côté il y avait ce but que j’avais à atteindre, but que je déduisais non pas de la connaissance que j’avais de l’objectif (à vrai dire, je ne savais que peu de choses à ce sujet) mais de la fermeté avec laquelle je pouvais refuser les fausses pistes, de l’autre se trouvait ce plaisir que j’éprouvais à la vue d’un pont, des bouquinistes, d’un détail, des passants, des lumières que je comparais à celles des jours précédents. Je marchais lentement, si lentement que je donnais l’impression de n’aller nulle part.
Comme un paradoxe : si j’allais au Louvre, aucun de mes pas m’en approchait ; je n’avais pas encore atteint le Pont des Arts que je m’y trouvais déjà. Où que je fusse, la sensation était la même : se sentir expulsé de là où j’étais.
La solitude avait produit en moi une autre voix que celle dont on se sert pour parler. Ma méditation ne s’appuyait pas toujours sur des mots et pouvait, à l’occasion, éclore des couleurs perçues, la voix provenir de plusieurs endroits à la fois, et se maintenir dans une zone hybride. Comme cela avait lieu dans l’espace, j’avais l’impression de rester dans un lieu ajourné pour les autres. Moi-même, en dehors du moment, quand je rentrais et que j’essayais d’y penser, je me sentais séparé de mon bien, incapable de faire la synthèse. Pourtant j’écrivais, j’écrivais comme on part à la pêche, sans savoir… disons que je notais, je notais pour ce moment où il me serait possible de déchiffrer
à quinze ans je faisais, en bord de mer, des promenades avec cette même appréhension, chassé d’où j’étais, j’improvisais dans la marche, j’allais du côté de la maison de Ada, sans me présenter ni m’approcher de trop, j’avais réussi à produire un silence qui me servait de bouclier, j’étais comme un chiot, avec des cailloux à la main, je me sentais accompagné. Il y eut cette séparation dans ma vie, cette nécessité de me forger une voie en dehors des protocoles, une douce mélancolie, j’enrayais une agression qui allait jusqu’à dans mes rêves, c’était comme un message que je ne comprenais pas, qui m’était destiné, et que je ne comprenais pas.
C’est l’intuition qui forge nos premières armes. Il peut s’écouler un temps plus ou moins long avant de l’apprendre, nous pouvons désespérer de ne pas voir l’issue, pourtant, c’est dans les moments les plus difficiles que ce qui paraît se présenter sous le signe de l’infortune récupère le tracé d’un choix — un trait qui nous représente, qui nous fait tenir alors que tout le reste est en retrait, mais nous ne pouvons rien dire, et c’est normal qu’il en soit ainsi, car nous ne pouvons pas présenter ce qui nous représente, puisque ce lieu nous l’occupons ; un secret est désormais notre place, et cette place est incommunicable, une âme si par « âme » nous entendons la forme d’un corps
parfois je ne savais plus l’âge que j’avais ; le souvenir n’avait pas la marque d’un temps révolu, il était comme de la pluie qui tombe, un même son sur le bitume. Quand nous vivons une douleur, en abrégé nous récapitulons les chagrins qui lui on précédé, ce sont eux qui façonnent la manière que nous avons de sentir, ou d’accorder plus d’importance à ceci plutôt qu’à cela, le temps est une denrée qui s’ajute avec le deuil et l’oubli, mais d’abord c’est le même chiffre frappe la peau du tambour,
… lors d’une de mes promenades, il arriva quelque chose qui me laissera dans le plus grand embarras… Je déambulais de salle en salle, mon trajet était irrégulier, je pouvais avancer sans regarder tableau puis m’attarder sur un détail ou me souvenir d’un autre, revenir sur mes pas pour vérifier mes sources. C’est lors d’un de ces changements de direction que j’ai la sensation, d’un côté, d’être suivi et, de l’autre, la certitude de que quelqu’un me suit. Un homme, dont je n’ai pas voulu voir ni visage ni rien, ni prêter attention par la suite ni vérifier mes soupçons. Rien. C’est arrivé quand j’ai voulu revenir sur un tableau qui se trouvait dans la salle que je venais de quitter, ne s’y attendant pas, l’homme afficha un sursaut et voulu se cacher se tournant vers le mur de clôture. Le geste était maladroit, et si évident que difficilement on pouvait lui attribuer une autre explication ; mais en même temps invraisemblable — qui pouvait bien me faire suivre ? Je croyais rentrer dans un cauchemar — alors là je suis foutu, fou à lier. Un terrain sablonneux où c’est la raison commence la besogne et la paranoïa qui la termine
J’eusse préféré ne pas y assister. Ma douleur fut intense et radical
mais comment dit-on ça quand trop de questions prennent lieu en un seul point et que le point éclate, s’étiole et part en milles morceaux ? Cela vous laisse à moitié ailleurs et ailleurs nulle part
pouvait être vrai, pouvait être faux, coïncidence avec quelque chose qui ne m’était pas destiné ? un concours de circonstances qui débouchait sur une certitude là où seule était vraie l’illusion ? comme ce manteau qui perché à l’entrée, quand on n’est pas prévenu nous fait croire à quelqu’un . Car qui pouvait bien me suivre ? Qui ?
Non ? Et si… non ? Je me refusais à admettre qu’à l’instigation de quelqu’un j’étais suivi. Les plus folles hypothèses. Non ? Crois-tu ? Une cascade de conjectures en roue libre. J’avais le souvenir d’une lecture de Sabato : le narrateur qui sans que nous ne nous rendions compte va passer du soupçon à la suspicion et de la suspicion à la certitude, basculer dans le délire : les aveugles sont une secte qui domine le monde,
non, je me trompais certainement. C’était mon état fébrile après tant de nuits blanches, travail dont je ne voyais pas le bout. Je savais ne pas avoir les moyens d’être certain de quoi que ce soit. La contrainte était double : si j’affirmais, je ne me laissais aucune chance de distinguer le vrai du faux, si je niais, je ne donnais plus de crédit à mes sens. J’étais nulle part. J’ai eu sommeil, mes yeux piquaient. C’était une intrusion dans ma vie privée. J’avais le vertige du seul fait d’y penser. Se dressaient autant de fantômes que des conversations j’avais avec moi-même. J’ai voulu oublier ce qui venait de se passer, mais c’était comme au billard, où une boule transmet le mouvement à l’autre… la cause n’était plus là où je l’avais rencontrée
mais comment dit-on ça quand trop de questions prennent lieu en un seul point et que le point éclate, s’étiole et part en milles morceaux ? Cela vous laisse à moitié ailleurs et ailleurs nulle part
comment allais-je faire maintenant ? ah ! mais je m’étais habitué à donner à ces divagations une matière plastique et musicale, elles pouvaient à tout moment laisser la place vacante. Des notions qui avaient le don de se succéder les unes aux autres. Je pouvais aussi bien les suivre d’après le vide que chacune laissait que l’étoffe qui était la leur — si vous pensez dans la langue, je disais, c’est aussi un manteau qui vous couvre, dans cette langue de tous les jours, dans cette manière de parler de tous les jours, dans cette manière imprécise de dire parce que chaque chose manque à sa place
soit, mais et si c’était vrai, et si quelqu’un… etc. Non, décidément s’en était trop… cela m’épuisait.
Une douleur chagrine restera dans l’air comme la seule chose viable. Je n’avais des tableaux que le souvenir d’une autre ville… Venise. Le jazz j’allais le rencontrer là même où j’avais suspendu mes visites, d’ailleurs, j’ignorais à l’époque que le Louvre allait me quitter pour un temps. Sept ou huit années. Let’s fall in love, Duke et Johnny en 1959.
Extrait de CABINET DES DESSINS

°°°
heurté
y faire le lien
cette chambre n’a d’autre réserve que le brun
et si elle peut ensuite trouver sa robe
ce sera le grenat
c’est là que j’ai vécu mes heures
l’aspect
°°°
ce qu’elle ouvrit dans la couleur
elle me donna ce regard pour que je lui verse sa soif
et l’orange s’est gravée en absence de source
nul besoin de la lampe
elle alla à tâtons
samedi, juin 17, 2006
Promenade : Le Marché de la Poésie
Une rencontre
sous le signe de Rimbaud
Voyelles
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrement divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !


sous le signe de Rimbaud
Voyelles
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;
U, cycles, vibrement divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges :
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
ATELIER TYPOGRAPHIQUE LE CADRATIN, Editeur
Jean-Renaud Dagon/ Rue de la Madelaine 10/ CH-1800 VEVEY- SUISSE
L’objet
Anik Vinay/ Emile-Bernard Souchière
84190 GIGONDAS/ Tél: 04 90 65 82 05 / Email: at-des-grames@libertysurf.fr
Deux photos
« Arrivée de toujours, qui t'en iras partout. »

°°°
A suivre en ce moment dans le blog : Manuscrit Jazz Quartet

vendredi, juin 16, 2006
Carta del padre II
LA MANO DEL HIJO
Bajamos el millón de gradas de la curvada escalera hacia la rue Blondel. Íbamos a telefonear a Bernardo para concertar un paseo. Me encerré en la cabina, contigo a mi lado, y conversé con él sobre planes para compartir. Bernardo no tenía ninguno, y ante una pregunta suya, yo respondí que nosotros tampoco teníamos planes. Esta respuesta provocó tu enojo, con cierta razón, pues efectivamente, algo habíamos organizado entre tú y yo, que en ese instante olvidé. Al salir de la cabina, me reprochaste severamente mi omisión: “¿ Por qué le dijiste que no teníamos planes cuando en verdad los teníamos?”. Te expliqué que se trataba de un olvido y te pedí perdón. Mientras caminábamos por el Bd. Sebastopol, insististe tanto y tan repetidamente en tu reclamo, que decidí regresar el departamento.
Confundido y dolido por el incidente, me dispuse primero a leer y después, a preparar mi comida. Estaba en eso cuando llegaste. Después de algunas vacilaciones, te sentaste a mi lado, y en gesto noble y afectuoso, me tendiste tu mano, tu mano amistosa y conciliadora. Fue un gesto parecido a un elocuente discurso donde las palabras sobraban. Yo me emocioné vivamente, pues el contacto de tu mano me produjo una infinita sensación de paz y regocijo.
Es que la mano de un hijo en la mano de un padre será una fiesta para el ánimo herido. Será siempre un Beau geste.
Así es. Uno de los recuerdos inolvidables de mi último viaje a París: tu mano en mi mano.
¿Te acordás, hermano?
CHILE-AGOSTO 2002.—
Bajamos el millón de gradas de la curvada escalera hacia la rue Blondel. Íbamos a telefonear a Bernardo para concertar un paseo. Me encerré en la cabina, contigo a mi lado, y conversé con él sobre planes para compartir. Bernardo no tenía ninguno, y ante una pregunta suya, yo respondí que nosotros tampoco teníamos planes. Esta respuesta provocó tu enojo, con cierta razón, pues efectivamente, algo habíamos organizado entre tú y yo, que en ese instante olvidé. Al salir de la cabina, me reprochaste severamente mi omisión: “¿ Por qué le dijiste que no teníamos planes cuando en verdad los teníamos?”. Te expliqué que se trataba de un olvido y te pedí perdón. Mientras caminábamos por el Bd. Sebastopol, insististe tanto y tan repetidamente en tu reclamo, que decidí regresar el departamento.
Confundido y dolido por el incidente, me dispuse primero a leer y después, a preparar mi comida. Estaba en eso cuando llegaste. Después de algunas vacilaciones, te sentaste a mi lado, y en gesto noble y afectuoso, me tendiste tu mano, tu mano amistosa y conciliadora. Fue un gesto parecido a un elocuente discurso donde las palabras sobraban. Yo me emocioné vivamente, pues el contacto de tu mano me produjo una infinita sensación de paz y regocijo.
Es que la mano de un hijo en la mano de un padre será una fiesta para el ánimo herido. Será siempre un Beau geste.
Así es. Uno de los recuerdos inolvidables de mi último viaje a París: tu mano en mi mano.
¿Te acordás, hermano?
CHILE-AGOSTO 2002.—
Y no se olviden de leer o releer este mes: Liliana llorando de Julio Cortazar, es el primer cuento de Octaedro.
jeudi, juin 15, 2006
El laberinto
Tout être vit dans un obscur labyrinthe et tout être attend l'attaque d'un Actéon redoutable. Tout être attend et cherche son Ariane pour nourrir l'espoir du retour et le bonheur dans le cas d'une victoire sur la bête du destin. Celle-là est l'idée bizarre qui nous provoque le miroir, la perplexité, et qui nous construit la littérature. Et le jeu de cette idée. Parce que la littérature est aussi… un labyrinthe de jouet, un labyrinthe artificiel. Le résultat d'un livre qui se regarde dans le miroir d'un autre livre et celui-ci dans le suivant et ainsi incessamment jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'au début ? Parce que rien existe, rien doit être attendu, ni même l'attaque de ce fauve de l'art ou l'immortalité. Jamais, ne viendra, non plus aucun Thésée, personne ne nous libérera de cette peine
Todo ser vive en un oscuro laberinto y todo ser espera la embestida de un temible Acteón. Todo ser espera y busca su Ariadna para alimentar la esperanza del regreso y la felicidad en el caso de una victoria sobre la fiera del destino. Ésa es la idea rara que nos provoca el espejo, la perplejidad, y que nos construye la literatura. Y el juego de esa idea. Porque la literatura es también... un laberinto de juguete, un laberinto artificial. El resultado de un libro que se mira en el espejo de otro libro y éste en el siguiente y así incesantemente hasta el final de los tiempos, o ¿hasta el comienzo? Porque nada existe, nada debe esperarse, ni siquiera la embestida de la fiera del arte o la inmortalidad. Tampoco vendrá nunca ningún Teseo, nadie nos liberará de esta condena
J. L. Borges
Audio, en français/JORGE LUIS BORGES - Fictions, La loterie à Babylone (1941)
samedi, juin 10, 2006
vendredi, juin 09, 2006
Paris la nuit

Sensation
Parfois il suffit d’un instant pour que notre rapport à la ville change.
L’été, la chaleur du soir. Sortez ! Qu’il faut à nouveau l’inventer.
Une longue promenade. J’ai vu des gens se parler autour d’un verre.
Un petit fromage par-ci, une fanfare plus loin.

Imaginez Sonny Rollins jouant sur un pont…
Ou lisez la nouvelle de Cortazar : L’homme à l’affût

Para los que leen en espagnolos voici en ligne
mardi, juin 06, 2006
dimanche, juin 04, 2006
Inscription à :
Commentaires (Atom)